Division en copropriété : pourquoi la loi veut-elle votre peau ?


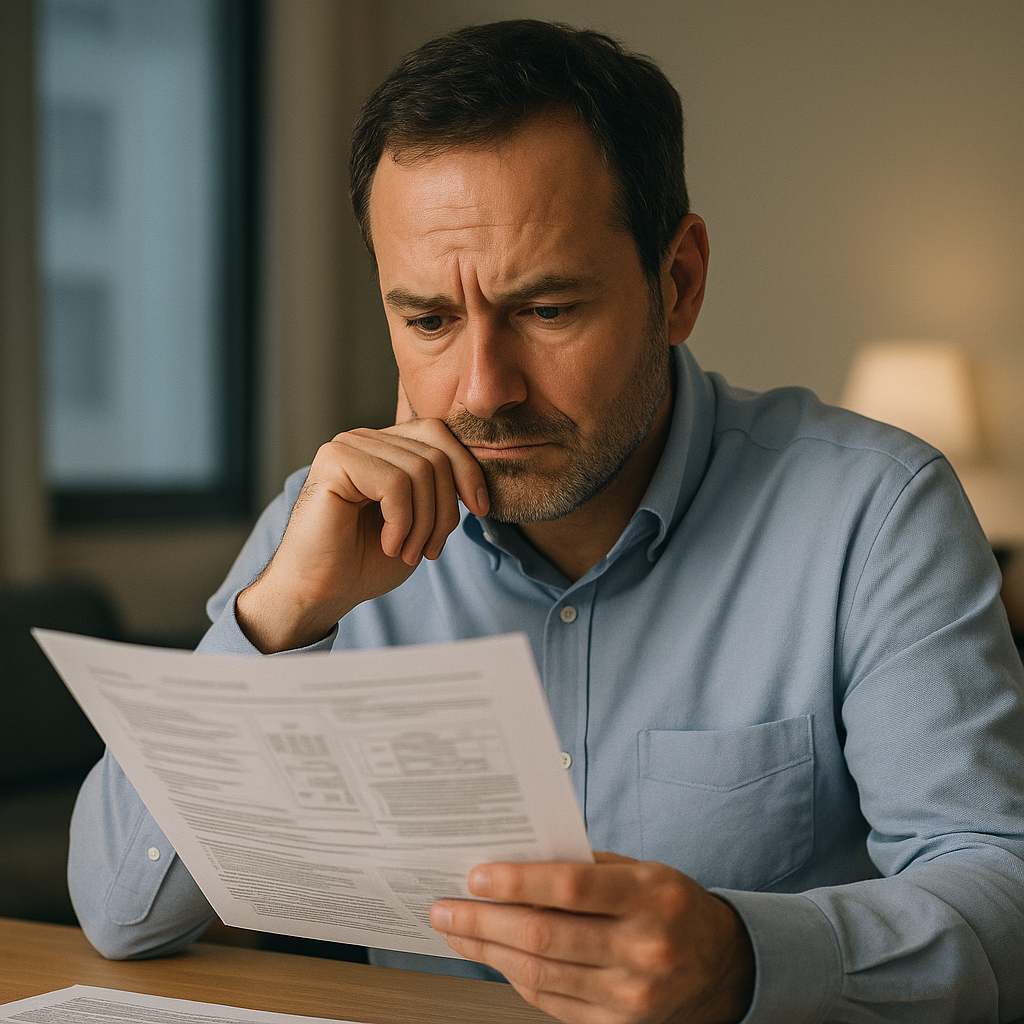
La division d'immeuble, c'est un peu comme un passage devant le fisc : on sait qu'on va morfler, mais on ne sait jamais exactement comment. Depuis quelques années, le législateur s'acharne sur cette pratique avec un zèle qui frise l'obsession. Entre diagnostics obligatoires, autorisations multiples et interdictions qui tombent comme à Gravelotte, diviser un bien relève désormais du parcours du combattant.
Nous qui manipulons ces dossiers depuis des années, on a vu passer bien des modes réglementaires. Et franchement, celle-ci mérite qu'on s'y arrête.
Depuis juillet 2021, impossible de transformer un immeuble de plus de 10 ans en copropriété sans passer par la case diagnostic technique global. Une obligation qui sonne comme un euphémisme : on ne "diagnostique" pas, on ausculte, on radiographie, on dissèque.
Ce DTG, c'est l'équivalent immobilier d'un bilan de santé complet avant une opération à cœur ouvert. État des parties communes, situation juridique du syndicat, améliorations possibles, performance énergétique, et surtout : l'évaluation des travaux nécessaires sur les dix prochaines années. Autant dire qu'après ça, plus question de jouer les innocents.
L'idée n'est pas mauvaise en soi. Elle force les futurs copropriétaires à ouvrir les yeux avant de signer. Fini le temps où l'on découvrait six mois après l'achat que la toiture partait en vrille et que les canalisations dataient de Napoléon III.
Mais cette transparence forcée a un prix : elle ralentit les opérations et augmente les coûts. Pour les petits investisseurs qui misaient sur la division rapide d'un bien ancien, c'est un coup de massue.
Le législateur a dressé une liste d'interdictions qui ressemble à un catalogue de tout ce qui peut mal tourner dans l'immobilier. Et il faut reconnaître : ils n'ont rien oublié.
Interdiction de diviser un immeuble frappé d'arrêté de péril ou déclaré insalubre. Logique. Interdiction de proposer des locaux sans eau, électricité ou évacuation des eaux usées. Là, c'est du bon sens élémentaire.
Ce qui interpelle, c'est la systématisation. Avant, ces règles relevaient souvent du cas par cas, de l'appréciation locale. Désormais, c'est du droit dur, national, uniforme. Plus de négociation possible avec le maire du coin ou l'architecte des Bâtiments de France.
Cette rigidification reflète une méfiance croissante envers les opérations de division. Le message est clair : diviser, c'est suspect par principe. Il faut prouver son innocence avant de pouvoir procéder.
Avec la loi ALUR, les collectivités peuvent désormais exiger une autorisation préalable pour toute division créant plusieurs logements dans un immeuble existant. Une révolution silencieuse qui redonne aux maires un pouvoir de vie ou de mort sur ces opérations.
Dans les zones où "l'habitat dégradé risque de se développer" - formule délicieusement floue -, l'autorité locale peut refuser la division si elle estime qu'il y a "risque pour la sécurité ou la salubrité publique". Traduction : si ça ne lui plaît pas, elle dit non.
Cette subjectivation du droit immobilier pose question. Où s'arrête la protection légitime des occupants et où commence l'arbitraire ? Comment s'assurer que ces refus ne cachent pas d'autres considérations, moins avouables ?
Chez nous, on a appris à naviguer dans ces eaux troubles. Mais pour l'investisseur lambda, c'est un nouveau facteur de risque à intégrer. Et les facteurs de risque, ça se paie toujours.
La division par surélévation obéit à ses propres règles depuis 2014. Majorité des 2/3 des voix pour voter l'opération, droit de priorité pour les copropriétaires situés sous la surélévation lors de la vente. Du classique.
Ce qui l'est moins, c'est l'exception prévue dans les périmètres de droit de préemption urbain : là, la majorité simple suffit. Comprenne qui pourra cette distinction byzantine.
L'esprit de la réforme est pourtant cohérent : éviter que quelques gros copropriétaires imposent leurs vues à une majorité silencieuse. Mais dans les faits, ça complique encore les montages financiers et rallonge les délais.
Cette avalanche réglementaire transforme fondamentalement l'économie de la division. Là où il fallait quelques mois et une poignée de milliers d'euros, il faut désormais compter un an et souvent des dizaines de milliers d'euros de frais préalables.
Pour les gros opérateurs, ce n'est qu'un coût supplémentaire à répercuter. Ils ont les moyens d'absorber cette complexité administrative. Pour les petits investisseurs, c'est souvent rédhibitoire.
Le résultat ? Une concentration du marché au profit des professionnels aguerris et une raréfaction de l'offre de logements issus de division. Exactement l'inverse de ce que prétendait viser la loi ALUR.
Cette frénésie réglementaire révèle surtout une chose : la méfiance croissante du politique envers l'initiative privée en matière de logement. Plutôt que de faire confiance au marché pour s'autoréguler, on préfère multiplier les contrôles et les autorisations.
Le paradoxe ? En voulant protéger les locataires des divisions sauvages, on renchérit l'offre de logement et on exclut de facto les petits acteurs du marché. Une fois de plus, les bonnes intentions pavent l'enfer immobilier.